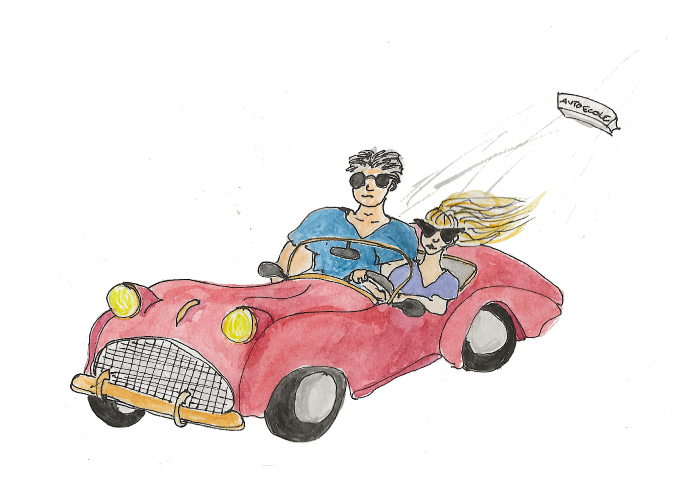Ce matin, le thermomètre de la pharmacie indiquait zéro degré. Il clignotait en vert et rouge et Marie le distinguait de loin en fermant un œil, puis l’autre. Sa vue avait encore baissé et l’opticien se ferait un bonheur de lui facturer 200 balles pour deux verres.
Elle n’avait pas 200 balles. Pas même 20 balles en poche, pour se payer un déjeuner au bistrot d’en face.
Il avait gelé et les fenêtres de son appartement s’étaient couvertes de givre. Le chat s’était lové dans son cou, comme pour lui donner le courage de se lever et d’affronter la bise. Ce matin, elle avait enfilé ses guêtres par-dessus son jean et avait ressorti sa grosse doudoune en plumes d’oie. Mitaines, bonnet, écharpe. Elle connaissait bien le froid de janvier à Paris, et n’avait pas eu besoin de la pharmacie pour savoir que la journée serait longue et glaciale sur les quais.
Sa boîte se trouvait rive gauche, sur le quai de la Tournelle près du pont de l’Archevêché. C’était un bon emplacement et les touristes affluaient sur l’île Saint-Louis, en mangeant des glaces en forme de rose de chez Bertillon.
Elle avait racheté sa boîte d’occasion, sept ans plus tôt, à un vieux bouquiniste de 90 ans, qu’il avait presque fallu évacuer manu militari tant il avait aimé sa vie de bohème.
Il s’appelait Joseph et les bouquinistes du quai le surnommaient « le vieux Jo ».
Il avait une collection d’estampes qu’on lui enviait jusque sur la rive droite et qui lui avait valu de faire parfois des affaires de haute voltige. Il y avait eu des jours heureux et puis des jours de pluies glaciales, où l’on sortait les capotes en plastique pour protéger ses trésors de papier.
Le jour où Marie avait commencé à organiser sa boîte, à disposer son stand avec application, elle avait senti qu’on l’observait avec rancœur. Dans leurs têtes à tous, elle avait mis le vieux Jo dans la tombe. Car parmi tous les secrets de jouvence du monde, c’était la passion pour son métier qui l’avait si bien conservé.
Le vieux Jo inspirait des poèmes à quiconque le regardait un peu, et on faisait vite abstraction de son air de mufle rustique. Marie, de son jeune âge, représentait la nouvelle génération des écrans et de la culture oubliée. Ils la surnommèrent Oblivion dans son dos. Et bien qu’elle ne le sût jamais, elle ressentait toute l’hostilité de leurs regards.
Mais Marie n’avait pas renoncé. Elle avait choisi la liberté d’une vie au rythme des saisons, à regarder passer les badauds, les clochards et les riches collectionneurs. Une vie à ne compter que sur les pièces dans ses poches.
À la mort de son père adoré, elle avait hérité de la petite librairie familiale, qu’elle avait aussitôt revendue pour se payer un appartement sous les toits. Elle s’en était mordue les doigts de culpabilité et avait erré un temps, l’âme en peine. Considérant mollement les faux métiers qu’offrait la société, sur un plateau de béton et de gratte-ciels lugubres. Des métiers de bureau, de support, du tertiaire comme on dit. Comme si ça voulait dire quoi que ce soit d’autre que de l’ennui en intraveineuse et une vie endormie.
Un jour, alors qu’elle cherchait de la vaisselle chez Emmaüs, elle était tombée sur une vieille collection de mangas oubliés. En les feuilletant, elle s’était sentie l’âme d’un archéologue en mission et décida de leur donner une nouvelle vie. Une sorte de dernière chance avant l’oubli.
Sa cargaison de livres sous le bras, elle marchait vite, quand soudain le fond du carton creva sous le poids. Juste devant une boutique appelée « Au Bled » qui vendait des caddies à 5 euros. Elle en avait choisi un au motif tartan écossais. Il lui rappelait un kilt qu’on l’avait forcée à porter le jour de la photo de classe.
Le caddie deviendrait bientôt son outil de travail phare, comme pour exorciser le souvenir du stupide kilt. En se plongeant dans les mangas, elle avait voyagé au Japon le temps de 25 tomes terrifiants, et l’envie de partager sa trouvaille était née. Elle apprit vite à chiner dans les brocantes et bientôt elle entra dans le cercle très fermé des bouquinistes.
C’était un milieu doux et familier, qui sentait le vieux papier et qui la replongeait tout droit dans la réserve de la librairie familiale.
Marie se considérait heureuse et libre. Deux qualificatifs qui s’appliquaient assez peu à la majorité du monde autour d’elle. Elle se sentait en marge, vivant au rythme des saisons et des reflets du ciel sur la Seine.
Il faisait un froid de loup et ses bouts de doigts étaient bleutés. À midi, elle avait commandé un jambon-beurre avec un café crème au bistrot, et s’était réchauffée les mains sous l’eau brûlante du robinet des toilettes. Puis elle les avait séchées longuement sous le séchoir à mains et avait fait rentrer l’air à l’intérieur de son pull par le col. Une fois, deux fois, et encore quelques fois, jusqu’à ce qu’une autre cliente entre et la déloge d’un regard gêné.
La matinée avait été lente et elle n’avait vendu que des cartes postales et une revue de mode ancienne. Elle avait attaqué à nouveau *Au bout de la nuit* de Céline, et cette fameuse ouverture qu’elle aimait tant : « Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. ».
Mais quelque chose clochait. Un sentiment de langueur, de monotonie, de vide. Pour la première fois en sept ans, elle sentait le froid lui crisper le cœur et jusque dans ses entrailles.
Elle retourna s’asseoir à son emplacement et essaya de se plonger dans sa lecture, en vain. Elle réorganisa un peu sa boîte, plastifia quelques nouveaux livres qu’elle avait acquis récemment et inscrivit les prix au marqueur noir.
Le vent lui fouettait le dos et balayait le quai. Une bruine fine se mit à tomber, et en aussi peu de temps qu’il n’en faut pour le dire, tous les bouquinistes avaient couvert leur emplacement. Comme le bal des ponchos multicolores d’Hanoï, qui surgissent à la première goutte de pluie, puis disparaissent à nouveau, le temps d’un battement de cil.
Et vous n’avez rien vu.
La pluie s’intensifia et on ferma les boîtes très vite, en grognant contre le changement climatique et les politiques qui sont responsables de tout, même de la pluie.
Marie les entendit partir un à un, mais ne bougea pas. Elle était transie de froid et resta assise sur son petit tabouret, les genoux entre ses bras, en regardant la pluie battre contre le plastique épais. Elle resserra un peu plus les livres autour d’elle, comme ferait une mère avec ses cannetons et se sentit seule à crever.
Elle se demanda si ce sentiment de solitude était le premier pas vers l’envie d’avoir des enfants, de procréer. Elle avait souvent pensé que les livres seraient ses enfants.
Pourtant, elle ne souhaitait pas fonder de famille. Au fond de son âme elle avait toujours su que cette vie ne l’appelait pas. Elle aimait les enfants des autres et gâtait ses neveux à la moindre occasion, mais son ventre n’appelait pas à être rempli. Elle ne ressentait pas le besoin de continuer sa lignée, de se reproduire, de créer un petit clone d’elle-même, de mettre un innocent au monde dans cette vie qu’elle trouvait trop dure.
Alors pourquoi cette solitude soudaine ?
Le rideau de pluie étouffa la lumière et bientôt il fit nuit. Il était à peine seize heures.
Elle chantonna. Une rengaine qui remontait de ses souvenirs, un chant populaire et vulgaire, d’une certaine Madeleine qui avait, dit-on, des mains d’obèse. Elle connaissait ce chant sans bien savoir comment et creusait ses méninges pour en sortir la suite des paroles.
Quand soudain, elle crut entendre un sifflement dehors.
Oui, quelqu’un sifflait et cette personne était tout près. Elle était sur le quai, et Marie distinguait sa silhouette tordue par le plastique épais de la capote.
La silhouette approcha et Marie manqua s’étouffer en reconnaissant la mélodie que l’inconnu sifflait. C’était Madeleine et ses mains d’obèse.
Elle eut soudain très peur et voulut partir en courant, mais déjà l’inconnu toquait contre la capote de sa main épaisse et, sans attendre de réponse, ouvrait le zip de bas en haut.
Marie crut défaillir avant de reconnaître l’homme qui entrait sans même se présenter.
— Bonjour ma chérie, quel temps de cornecul hein !
Elle voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Ce n’était pas réel, ça ne pouvait pas l’être.
Dans son poncho vert foncé, c’était son père qui se tenait là, devant elle. Il se dévêtit un peu et s’ébroua en prenant soin de ne pas mouiller les livres.
— Eh beh Marie, on salue plus son vieux papa ? demanda-t-il, l’air faussement offusqué.
Il ouvrit les bras et elle s’y blottit sans poser de question, son visage contre la poitrine épaisse de l’homme qu’elle avait perdu. Au creux de son amour, entre ces bras qui lui semblaient immenses, elle sentit son pouls contre sa tempe.
Ils restèrent un moment dans cette étreinte et leurs cœurs se parlaient en silence, racontant par échange de battements et de champs magnétiques tout ce qu’il y avait à dire.
Il se défit le premier de leur étreinte et l’observa de haut en bas :
— Tu as bien changé ma petite, regarde-toi comme tu es une belle femme.
— Merci, papa.
— Tu es heureuse au moins ?
— Oui, heureuse et libre. Tu vois, j’ai choisi la même voie que toi, celle des livres.
Il sourit d’un air désolé.
— Ce n’est pas la passion la plus facile, dirons-nous.
— Non, en effet, et surtout pas quand l’univers se déchaîne dehors.
Ils se regardèrent timidement et elle le trouva changé : il avait l’air plus jeune que la dernière fois qu’ils s’étaient vus. Il n’avait plus de cheveux blancs et ses joues étaient pleines et hautes, comme avant la maladie.
— Tu t’es fait une petite cure de jouvence au soleil, on dirait ?
— J’étais beau quand j’étais jeune, tu sais. Comme sur ces photos de moi que tu as accrochées sur ton mur, dans l’appartement.
Elle eut l’air surprise, et se rappela que rien de tout cela n’avait de sens et qu’il ne fallait probablement pas chercher d’explication du côté de la raison.
— Oui, j’aime bien ces photos, je les montre à mon chat.
Il prit sa main dans les siennes. Des mains chaudes et épaisses de travailleur.
— Ma chérie. Je suis venu pour te libérer d’une fausse idée que tu t’es faite.
Elle sentit sa gorge se nouer. Il continua :
— Je sais que tu me cherches dans chaque livre, dans l’odeur du papier, dans la sensation de la tranche sous tes doigts. Je sais que tu aimerais me faire revenir comme cela. Mais tu n’as pas besoin de t’enfermer dans une vieille boîte en bois pour que je sois auprès de toi. Il y a d’autres aventures à vivre.
Marie pleura en silence, et chaque larme aurait fait *plic ploc* par terre s’il ne pleuvait pas aussi fort dehors. Elle pleura longtemps, dans la chaleur de sa douce présence.
Et le jour se leva au loin.
Elle fut réveillée par les pattes duveteuses du chat, qui jouait avec ses cheveux déroulés sur l’oreiller. Il vint se lover dans son cou comme pour lui donner le courage de se lever et d’affronter ses rêves. Ses vrais rêves.